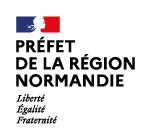« En 1938, quand Contrebande est publié, Enrique Serpa a 38 ans. Né à La Havane dans un milieu populaire, il a fait dès l’enfance toutes sortes de boulots : cordonnier, typographe, coursier en teinturerie, peseur de canne à sucre en usine. La capitale cubaine est alors un attrape-mouche et une centrifugeuse brutale pour les émigrants de toutes sortes : Espagnols, Chinois, Japonais, Européens de l’Est. Contrebande décrit cette ville où les misérables vont de bars en lupanars, veulent l’Amérique sans l’obtenir, n’ont pas de quoi nourrir leurs familles et jouent du couteau. Certains sont arrivés « dans des caisses de morue », d’autres ont connu le bagne. La plupart ont « d’âpres ricanements, ricanements d’hommes habituellement sombres à qui la pauvreté n’avait pas appris à rire ». Tout est envahi par une mer à la puissance non généreuse, les mots des pauvres, du sexe avide et sans joie.
À 20 ans, Serpa entre dans le cercle du premier des anthropologues de la culture afro-cubaine : Fernando Ortiz. Il devient membre d’un groupe d’avant-garde, les « minoristes », et publie un recueil de poèmes, le Miel des heures. Mais personne, à Cuba, ne vit de littérature. Il sera journaliste jusqu’à la fin de sa vie. Les descriptions de la pêche, de la vieille Havane, de l’anse portuaire, des bars et des femmes de nuit révèlent quel reporter il fut. Certaines scènes semblent datées de la veille, tant le temps, dans l’île, a faussé compagnie à l’avenir et à la raison. Ainsi sur le Paseo du Prado, cette « foule bruyante, facilement canalisée par la police, traversant la rue pour se rendre sur le Malecon, à la recherche d’un air frais venu de la mer » et probablement d’une chose qu’elle ne trouvera pas.
Le narrateur possède une goélette, la Buena Ventura. C’est un homme jeune, mal dans sa peau, d’une lucidité antipathique et aveuglément frustré, « un homme qui osait à peine s’avouer cette frustration dans l’intimité de sa propre conscience et qui, soudain, se détestait lui-même sans cesser de se débattre comme un calmar dans son encre, dans sa rancœur et son mépris de lui-même ». Le roman débute par une pêche au mérou qui ne rapporte rien et finit sur une livraison, à des Américains à l’aube, d’une cargaison de rhum. Un marin est assassiné et un autre, qui a tué sa femme à coups de couteau, s’éloigne sur le yacht yankee pour échapper à la justice. Le capitaine du bateau, Requin, « semblait avoir été taillé dans un bloc de cuivre pour incarner l’image du laisser-aller (…). Son intrépidité et un rostre d’espadon, taillé en forme de poignard et violemment plongé dans les cœurs d’autres hommes, lui avaient à deux reprises ouvert les portes de la prison ». Le roman alterne trois genres de séquences : descriptions réalistes, récit d’aventure, monologues intérieurs du narrateur dont la conscience perturbée, oscillant entre nausée et exaltation alcoolique, tamise tout.
Dès le début, il dit ceci : “ Plus tard, j’ai su qu’un autre écrivain venait souvent pêcher l’espadon en été, dans les eaux cubaines. Il s’appelait Hemingway, Ernest Hemingway. Je me sentis donc obligé de posséder (…) une de ses œuvres. Je parcourus en vain toutes les librairies de La Havane. Et je dus finalement me contenter de deux photos de lui, publiées dans un journal. J’en collai une, la plus grande, dans ma cabine. Et, quand quelqu’un s’enquérait de ce visage large et souriant de Nord-Américain débordant de santé, je précisais que c’était celui d’un millionnaire de mes amis. ” » Philippe Lançon, Libération