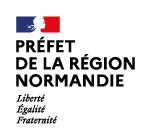La Montagne de minuit, de Jean-Marie Blas de Roblès : un Tibet de fantasmes
Il y a de cela deux petites rentrées littéraires, le précédent ouvrage de Jean-Marie Blas de Roblès, Là où les tigres sont chez eux, avait entraîné public et critique dans un tourbillon d’érudition joyeuse et épique, récoltant au passage un prix Médicis mérité. Roman-somme, fleuve et encyclopédique, il débordait tant de gai savoir que d’élan vital et de plaisirs littéraires. Au premier abord, La Montagne de minuit fait jouer les contrastes en avançant la carte de la sobriété et du dépouillement, là où son précédent préférait foisonnement et démesure. La magie qui s’opère n’est pourtant pas moins forte ou impérieuse.
Plus qu’à la lecture d’un roman, c’est au spectacle de la fabrique d’un récit que Blas de Roblès nous convie. Deux voix s’entrecroisent : celle d’un écrivain, Paul, qui cherche à recréer un épisode de la vie de sa mère, à partir des souvenirs de l’enfant qu’il était alors, et celle de la mère, Rose. Historienne de profession, celle-ci commente, au fil de sa lecture, les chapitres que lui présente son fils, apportant remarques, corrections, révélations et interrogations.
Au centre de tout cela, la figure de Bastien Lhermine, vieil homme un peu mystérieux, gardien de lycée à la retraite, mais aussi érudit, expert en langues orientales, passionné de lamaïsme et pratiquant la méditation et le tai-chi. Rose, après s’être liée d’amitié avec cet étrange mais attachant voisin, décide de lui offrir le voyage à Lhassa dont il a rêvé toute sa vie. Au Tibet, où il est victime d’un accident cérébral dont il mourra peu après, Bastien confie à Rose le secret qui gouvernait son existence : durant la seconde guerre mondiale, il aurait fait partie des “Brigades tibétaines”, une division SS fascinée par l’ésotérisme et les sagesses asiatiques. Lorsque, des années plus tard, Rose entreprend des recherches, elle découvre pourtant que ces Brigades n’ont jamais existé. Il s’agit en fait d’un mythe véhiculé par une littérature visant à réhabiliter certains aspects du nazisme et relayée par des auteurs aussi prompts à l’affabulation que peu soucieux d’exactitude historique. L’aveu de Bastien n’était pas la révélation d’une vérité, mais une invention, un mensonge destiné à faciliter le travail de deuil de Rose, à “l’aider à trouver le sommeil”.
Entamée comme une évocation intime et émouvante, conclue comme une réflexion aux résonances profondes sur les pouvoirs et les dangers de la fiction, du mythe et des contes, La Montagne de minuit captive par son récit maîtrisé jusque dans ses moindres détails. Ce qui pourrait apparaître comme cliché ou déjà-lu y sonne étonnamment juste, tout didactisme en est exclu et la complexité de la polyphonie qu’il met en oeuvre ne nuit en rien à son charme.
Renvoyé, à travers les destins des personnages comme à travers l’évocation de la grande Histoire, de mensonges en omissions et en petits arrangements avec la réalité, le lecteur se retrouve aux prises avec le statut même de la fiction : cet espace fuyant et obscur nous trompe autant qu’il nous soulage. “Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, remarque l’un des héros en citant Chesterton, ce n’est pas qu’ils ne croient plus en rien, c’est qu’ils sont prêts à croire en tout…” C’est à l’écrivain, comme à l’historien, de “s’efforcer d’inventer la vérité”, une vérité mise à mal à tout propos et pour servir des desseins plus ou moins obscurs et légitimes.
La peinture faite, en toile de fond, d’un Tibet sous domination chinoise, déchiré entre les traces d’une sagesse ancienne et ce qu’impose l’armée d’occupation, ne laisse guère de doute : le “mythe” se résume parfois au mensonge, à l’oblitération de la vérité. Mais quand il prend la forme de contes ou de légendes, il peut aussi devenir un irremplaçable pansement de l’âme, qui aide tout simplement à vivre.
L’une des grandes forces de La Montagne de minuit est de poser plus de questions qu’elle n’offre de réponses – car la plupart d’entre elles, préparées et prémâchées par la pensée d’autrui, seraient trop aisées, tronquées et forcément trompeuses. Avec une élégance et une sorte d’évidence émouvante qui parle au coeur autant qu’à la raison, elle se révèle un formidable appel aux pouvoirs de la connaissance face aux dangers de l’obscurantisme. En peu de pages, Blas de Roblès parvient à ouvrir tellement de portes dans l’esprit de son lecteur que son roman, s’échappant de son cadre et de ses circonstances, se fait merveilleuse matière à réflexion et à apprentissage.
Benjamin Fau, Le Monde des livres, 9 septembre 2010.