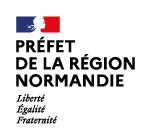Entretien réalisé par Ariane Singer pour Transfuge
D’où vous est venue l’idée d’écrire le Peintre d’éventail ? En quoi l’écriture de votre ouvrage le Jardin des peintres, paru en 2000, a-t-elle préparé ce roman ?
H.H. J’ai toujours été fasciné à distance par le Japon, par l’insensé raffinement d’une civilisation qui a fondé sa réalité sensible sur l’espèce de qui-vive de l’impermanence entre deux cyclones ravageurs et dans l’attente soutenue du prochain séisme, par ce mélange d’aménité et de violence contenue aussi, l’espèce de sacralisation de la mémoire dans un environnement sans consistance, sur un sol instable, toujours en péril de disparition (ce qui à mon sens, rapproche quelque peu l’âme nippone de celle des juifs de la diaspora lesquels ne pouvaient préserver que cette merveille fragile du temps dans un monde qui fomentait leur destruction). Cette passion contemplative, annihilante, devant les espaces naturels composés (du jardin, de la peinture), je l’éprouve sans cesse moi-même. Le Jardin des peintres, paru chez Hazan, traverse l’histoire de l’art : le jardin peint, fresque, vignette ou pleine toile, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, c’est un regard sur une fragilité comme suspendue, c’est presque l’équivalent du visage (j’ai écrit aussi un essai sur le visage, Du visage et autres abîmes, qui réfléchit sur la pérennité du non être, le visage étant une sorte de jardin de l’être intérieur, pure vacuité que chacun cultive à sa manière).
A quel moment est intervenue l’écriture des Haïkus du peintre d’éventail?
H.H. Un matin de l’autre hiver, sans raison, je me suis mis à écrire des haïkus, et je n’ai plus cessé pendant des semaines, des mois, pas loin de mille haïkus comme si j’étais habité, hanté plutôt. J’aurais pu continuer indéfiniment dans un coin de la côte normande où j’aime m’isoler, devant les sources d’un fleuve minuscule. Et puis je me suis dit que, forcément, ces haïkus n’étaient pas de moi, juif tunisien de l’exil, mais d’un personnage venu me hanter : c’est ainsi qu’est né le peintre d’éventail, que le roman a pris forme dans mon esprit presque instantanément. C’est ainsi que je me suis mis à l’écrire avec un sentiment de nécessité étrange, paradoxale, sans esprit d’exotisme et de couleur locale à la Loti, comme si j’avais vécu l’aventure de Matabei Reien. La plupart des quelques haïkus inclus dans le roman le furent au fil de l’écriture du roman. On en trouve seulement deux je crois dans les Haïkus du peintre d’éventail, le recueil qui accompagne la publication du Peintre d’éventail, et dans lequel j’ai sélectionné une moitié des mille haïkus écrits dans un état de dédoublement méditatif, à la source du roman.
Avec le Peintre d’éventail, vous réalisez un tour de force : nous laisser penser, par la précision dans les descriptions de paysages, et la connaissance en profondeur des us et coutumes des Japonais, qu’il s’agit d’un vrai roman japonais. Or, vous n’y avez jamais mis les pieds. Quel est donc votre rapport au Japon ?
H.H. Je crois que le romancier a plus de chance de recréer un monde grâce au travail de l’imaginaire, à ses pouvoirs quasi hallucinatoires, que dans une relation clinique d’observateur. La culture nippone dans ses œuvres vives, tant picturales que littéraires, musicales ou cinématographiques, dans sa pensée merveilleuse qui est le comble de l’intuition, m’aura bien sûr inspiré à l’origine. Mais j’ai vécu dans l’écriture de ces deux livres un état curieux, comme une vie antérieure ou parallèle qui me privait d’autres repères identitaires. D’ailleurs, à part mon roman sur la guerre d’Algérie écrit longtemps après l’avoir visitée (en 1969), je suis toujours allé dans les lieux de mes romans après les avoir décrits, tant l’évocation onirique prime. Je me suis trouvé à Montréal quand j’écrivais sur New York, sans faire l’effort de prendre l’avion ou même le train. Opium Poppy (qui paraît en Folio en janvier) parle des enfants soldats en Afghanistan, mais c’est lors d’un voyage au Rwanda que le sujet m’est venu. Je reviens une fois de plus d’Inde du sud, un peu désespéré de ne pas pouvoir écrire encore l’histoire du royaume juif de Cranganore, à cause de ce conflit de la réalité justement. Un romancier est un reporter de l’imaginaire toujours en retard d’un voyage.
Quel est votre rapport à sa littérature ? Quels sont vos auteurs de chevet ?
H.H. Surtout le fonds légendaire, les contes terrifiques pour faire évanouir les enfants, le théâtre no, les grands maîtres du zen en relation avec le Tao, tout vient de la Chine mais filtré entre des phalanges transparentes. Les dames de cour, comme Murasaki Shikibu (Le Dit du Genji) ou Sei Shonagon (Notes de chevet) qui, peu versée en mandarin, ont fondé la littérature japonaise en osant faire usage d’une langue simplifiée vernaculaire alors que les clercs s’imposaient alors un chinois empesé un peu comme nos latinistes médiévaux ; Chikamatsu Monzaemon qu’on surnomme le Shakespeare nippon, les haïkistes magistraux comme Buson, Isé, ou l’auteur de la Sente étroite du Bout-du-Monde. Kawabata et son Maître ou le Tournoi de go. L’extraordinaire Mishima, aussi incompréhensible aux Japonais qu’Edgar Poe l’est aux Américains (je découvre aujourd’hui avec surprise un très beau roman de lui étrangement proche du Peintre d’éventail dans ses prémices : Après le banquet). J’ai encore tellement à lire, les estampes d’Hiroshige m’émerveillent comme les planches d’Hergé quand j’avais dix ans. C’est vrai que la peinture m’importe tellement. Je suis peintre moi-même, j’y travaille du moins depuis longtemps, comme mon frère Michael, qui m’aura inspiré Palestine des années après son suicide, l’était vitalement. Ce rapport vécu entre poésie et peinture, par-delà les circonstances, c’est ce qui explique peut-être l’aspect un peu invraisemblable de ces deux livres, pour ce qui concerne leur conception.
Vous avez écrit sur la Palestine, l’Afghanistan, et maintenant sur le Japon après Kobe et après le tsunami de 2011. Qu’est-ce qui vous touche autant dans ces territoires meurtris ?
H.H. Ce qui nous touche tous, l’infinie tragédie des créatures abandonnées. C’est une aporie de la sensibilité, de l’esprit. Nous ne cessons de parler abstraitement d’altérité, tandis qu’à chaque seconde un génocide épars frappe les enfants, les femmes, les hommes, les animaux sur la planète. Et puis soudain, un visage réel ou imaginaire vient vous regarder d’un endroit précis du monde à travers cette tragédie permanente et puis, sans trop comprendre d’où naît l’urgence, c’est une histoire singulière qui commence à s’écrire.
Vous dites de l’éventail qu’il est « le manuel du parfait jardin ». Que faut-il y voir d’autre ? Un outil de transmission entre générations qui va au-delà de la simple transmission d’un savoir ? La permanence de l’art par-delà les destructions ?
H.H. Oui, c’est cela, cette permanence d’une fragilité miraculeuse dont l’art témoigne alors que les phénomènes passent comme l’écume sur une mer agitée. La vie ne s’appuie sur rien, les civilisations sont des songes de papillons. Pourtant ce « chemin de rosée » inclut au même titre la fragile seconde toujours renaissante et l’éternité relative des galaxies.
L’irruption de la passion (avec l’arrivée d’Enjo) met fin à l’harmonie du jardin zen. Quel lien avez-vous voulu créer entre cette rupture et les cataclysmes naturels qui s’abattent sur l’île ?
H.H. Le cataclysme qui s’abat donne la vraie mesure de cette fragilité vivante du jardin lequel il faut entretenir par des soins précieux, quotidiens, comme un organisme à notre image. L’irruption d’Enjo, de la passion et du poids de la culpabilité, semble briser un charme, comme si le temps suspendu sur un prodige d’harmonie reprenait un cours fatal. Il n’y a pas de rapport de causalité bien sûr, mais de composition : nous sommes dans l’espace dramatique du roman, de la fiction. Le Peintre d’éventail met en activité les mythes shinto et les légendes bouddhistes, sur fond de vie quotidienne.
La notion de transgression est forte dans le roman : le fait que Matabei séduise Enjo alors qu’elle devrait « revenir » au plus jeune (Hi-han), la présence dans la pension de différents personnages qui portent chacun une forme de culpabilité (Matabei, ancien « meurtrier », un couple adultérin, une ancienne courtisane). Y a-t-il dans votre esprit une notion de châtiment divin, ou de « juste » retour des choses, qui expliquerait que ces « Évaporés » soient tous rattrapés par la destruction de leur Eden?
H.H. Tous les pensionnaires de dame Hison sont des solitaires marqués par un drame souvent lié à l’histoire récente du Japon. Grâce au jardin, dans la discrétion des éventails qui recèlent son secret, le temps semble s’arrêter, quelque chose d’ineffable retient l’instant. Les représentations où nous construisons notre demeure sont de pures illusions face à la vague scélérate du temps, elles laissent jouir parfois d’un moment béni. Macbeth n’est jamais plus japonais (souvenez-vous du Château de l’araignée de Kurosawa) que lorsqu’il déclare à peu près : La vie cette ombre qui passe, ce pauvre acteur qui s’agite et parade une heure avant de se taire. Le romancier est sans doute lui-même cet idiot qui raconte un récit plein de bruit et de fureur, mais dont il laisse le sens en suspens. On verra bien si le lecteur le trouve.
Il y a une différence nette entre la façon dont les Japonais ont été présentés après le cataclysme (comme faisant preuve d’un stoïcisme à toute épreuve) et la façon dont Matabei réagit, en cédant au désespoir et en choisissant la mort. Qu’avez-vous voulu montrer par là ?
H.H. C’est une représentation convenue, à la fois sociométrique et idéologique, que le stoïcisme nippon face à l’adversité, lequel ne manque d’ailleurs pas de vérité et j’y fais souvent allusion dans les haïkus. Mais l’humain est l’humain sous tous les cieux. Et puis la réalité des destins individuels soumis à la douleur extrême de la perte, même un vieux samouraï la subit. La mort consentie appartient pleinement à la culture nippone, tant bouddhiste que shintoïste : comme ce moine qui se laisse momifier vivant au milieu des fumigations. Et l’on connaît le code d’honneur des samouraïs. Matabei ne réagit pas de manière désespérée même s’il est comme anéanti par les événements. Il se ressaisit au contraire et dans son dénuement, il va accomplir tous les rites sacrés qu’on doit à ceux qui furent, aux disparus, avant de se mettre corps et âme à une œuvre de rédemption exemplaire par la restitution des éventails détruits, par la magie de l’art. Il ne choisit pas la mort, il est déjà mort d’une certaine manière, et c’est dans la sérénité retrouvée qu’il accepte un dernier rituel, une fois son œuvre accomplie.